Pour
des hommes « qui ne sont pas rentrés dans l’histoire », les Africains
d’aujourd’hui sont bien créatifs, combatifs et solidaires. C’est ce que
montre le livre de Daniel Dupuis qui a recueilli de nombreux
témoignages d’hommes et de femmes à l’action dans divers pays d’Afrique
de l’Ouest. L’auteur met en balance cette réalité avec le discours
raciste qui, de Voltaire à Sarkozy, justifie la colonisation.
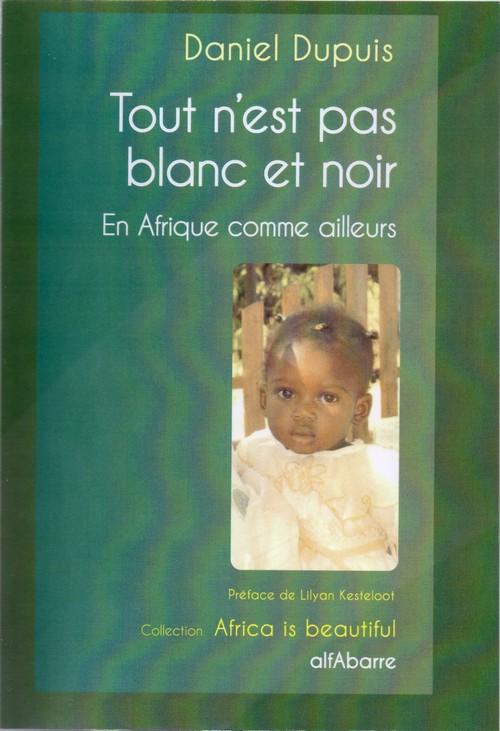
Daniel
Dupuis nous invite, à travers ces pages, à un va-et-vient entre d’un
côté le discours de grands écrivains et hommes politiques français, du
XVIIIe siècle à nos jours – un discours qui célèbre uniformément la
supériorité de la race blanche -, et de l’autre côté la rencontre
d’Africains d’aujourd’hui, qui construisent pierre à pierre leurs
sociétés et leur avenir.
L’imaginaire raciste vient de loin, explique Daniel Dupuis, qui cite souvent les travaux de Survie et en particulier l’ouvrage d’Odile Tobner « Du racisme français »
(Ed. Les Arènes, 2007). Les « nègres », dit Voltaire, sont
prodigieusement moins intelligents que les blancs. Pour Montesquieu, ils
sont « naturellement paresseux » et pour Hegel ils représentent
« l’homme naturel dans toute sa barbarie », sans « moralité » ni
« sentiment ».
Cet
imaginaire n’est pas neutre, il contribue à justifier la conquête
coloniale, comme le fait Victor Hugo en 1879 : « L’Afrique n’a pas
d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe. » Aussi
l’Europe est-elle selon lui légitime à faire de l’Afrique « un monde » :
« Allez, Peuples ! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. A qui ? A
personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes.
Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la. »
Ernest
Renan (1823-1892) prône « la régénération des races inférieures ou
abâtardies, par les races supérieures ». Pour lui, la « race chinoise »
est une race d’ouvriers, « le nègre » est fait pour travailler la terre
et il y a « une race de maîtres et de soldats, c’est la race
européenne. » Jules Ferry ne dénote pas, en estimant que les « races
supérieures » ont « le devoir de civiliser les races inférieures ». Ni
Léon Blum (1872-1950) qui, avec d’autres mots, tient à peu près le même
discours.
Aussi
ne faut-il pas s’étonner du vote, le 23 février 2005, par les
parlementaires français d’une loi évoquant « le rôle positif de la
présence française outre-mer », en oubliant de parler de rôle négatif.
Aimé Césaire (« Discours sur le colonialisme », 1955) avait pourtant
dressé le bilan de la colonisation : des « sociétés vidées
d’elles-mêmes, des cultures piétinées », les milliers d’hommes sacrifiés
à la construction du chemin de fer Congo-Océan (15 à 30 000), « les
millions d’hommes à qui l’on a inculqué savamment la peur, le complexe
d’infériorité… », « les cultures vivrières détruites, la
sous-alimentation installée… ». Et puis il y a les millions (de 11 à 20
selon les estimations) d’Africains victimes de la traite.
Lorsque
le 26 juillet 2007 le Président de la République Française, Nicolas
Sarkozy, dans son discours de Dakar, estime que « l’homme africain n’est
pas assez entré dans l’histoire » et qu’il « ne s’élance jamais vers
l’avenir », il y a, dit Daniel Dupuis, « de l’arrogance et du
paternalisme » et surtout beaucoup d’ignorance et d’inculture ; et c’est
en même temps la perpétuation d’une culture raciste et colonialiste
française.
Terre d’espoir
A
l’inverse des affirmations du journaliste franco-américain Stephen
Smith (« Négrologie », Calman-Levy, 2003), pour qui l’Afrique est un
« Ubuland sans frontières, terre de massacres et de famines, mouroir de
tous les espoirs », l’Afrique, estime Daniel Dupuis, fourmille de
ressources… humaines qui s’emploient à construire un monde meilleur.
Et
l’auteur en donne de nombreux exemples, à travers des témoignages
recueillis en 2010 et 2011 au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au
Sénégal et au Bénin.
Parmi
eux, Germain Ouédraogo évoque le théâtre d’intervention sociale, qui
contribue à la sensibilisation des spectateurs, par exemple sur des
questions comme l’excision, la scolarisation des filles, la culture
biologique…
Un
chapitre est consacré aux « écologistes en action », dont Haïdar el
Ali, fondateur de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal,
à l’origine de la plantation de plus de cent millions de palétuviers
pour reconstituer la mangrove du littoral de la Casamance.
Les
chanteurs, comme Didier Awadi, Smockey, Sam’sklejah, sont pour leur
part engagés dans la dénonciation de la misère, du chômage, de
l’analphabétisme et de la corruption. Les deux derniers sont à l’origine
du « Balai Citoyen » (2013), mouvement qui a fortement contribué au
départ de Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso.
Les
femmes sont à l’origine de nombreuses initiatives, pour la
scolarisation des adolescentes, pour l’alphabétisation des femmes, la
connaissance de leurs droits, leur formation à la gestion, contre
l’excision, la polygamie… Françoise Bibiane Yoda et le réseau Femmes en
action accompagnent les associations dans le développement d’activités
génératrices de revenu.
Il
y a aussi les paysans, tel Yacouba Sawadogo (Burkina), qui a encouragé
la diffusion de techniques adaptées à l’environnement sahélien (zaï,
demi-lune) et qui, comme Mamadou Diakité (Mali), a promu la régénération
naturelle assistée : en plantant des arbres selon des techniques
simples et appropriées des centaines de milliers d’hectares du Sahel ont
échappé à la désertification.
Au
Burkina, les Groupements Naam travaillent aussi pour un développement
agricole solidaire, respectueux de l’homme et de la nature, et pour la
sécurité alimentaire.
Ousmane
Tiendrébéogo, lui, se bat contre le coton OGM de Monsanto, qui endette
les paysans et cause leur expulsion au profit de grandes entreprises
financières.
Des
exemples d’activités dans le secteur informel (à Cotonou notamment),
illustrent la faculté d’adaptation des Béninois, entre autres, dans une
économie dominée par un système économique néo-colonial.
Daniel
Dupuis donne aussi la parole aux militants politiques,
altermondialistes par exemple, comme Moussa Tchangari et Ali Idrissa
(Niger), qui dénoncent les conditions de l’exploitation de l’uranium par
Areva ; ou comme Samba Tembely au Mali (Coalition des alternatives
africaines dette et développement.
Nous
sommes donc loin de l’inertie et de l’indolence d’indigènes assommés
par le soleil tropical ou inhibés par leur incapacité à prendre en mains
leur destin. Adama Ba Konaré avait écrit un « Petit précis de remise à
niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy » (La
Découverte/Poche 2009). Le livre de Daniel Dupuis est une sorte de petit
précis des initiatives et du courage humain. A lire absolument pour
avoir un aperçu d’une réalité assez largement ignorée par les médias
français, encore en 2016.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire